Le mythe de la chute et la fiction d'un homme innocement : Interprétation littérale et interprétation libérale du péché
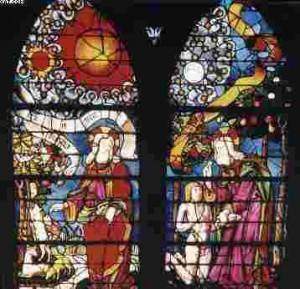 Tout change donc selon que l’on déclame : « Dans la faute je fus enfanté, pécheur m’a mère m’a conçu » ou que l’on déplore : « Il n’en est pas un qui fasse le bien, non, pas un seul ». L’idée d’une faute héréditaire, sans doute, est contradictoire, mais celle d’une liberté innocente ne l’est pas moins, si l’on veut bien donner à « innocente » un sens relatif à la conduite individuelle. La liberté ne mérite son nom que parce qu’elle a le choix du bien ou du mal. La supposer innocente serait supposer ou qu’elle choisit toujours le bien ou qu’elle ignore le mal. Mais, dans le premier cas, elle ne serait pas une liberté humaine ; et, dans le second, elle ne serait pas du tout une liberté (l’innocence ne se distinguant plus alors de l’ingénuité ou de la stupidité et perdant du même coup sa valeur morale). Sans doute Kierkegaard remarque-t-il que « dans l’homme depuis Adam, tout individu i ou doit avoir un état d’innocence analogue à celui d’Adam », mais il veut seulement rejeter de cette manière une interprétation déterministe et naturaliste du mythe d’où « sortirait un individu n’en étant pas un et qui ne serait qu’un simple in-plaire de son espèce », « sans qu’on pût pourtant lui ôter le propre de l’individu : la culpabilité ». L’antériorité d’un tel état d’innocence n’est pas chronologique mais purement logique : elle permet seulement de se représenter le « saut » qu’implique la liberté de l’homme qui « plonge dans son propre possible » et qui, lorsqu’il se relève, « se voit coupable ». C’ est dans ce sens que l’on peut lire déjà, dans l’Apocalypse de Baruch: « Adam n’est pas responsable, si ce n’est pour lui seul. Et tous nous sommes pour nous-mêmes Adam ». Plus qu’une préhistoire mythique du genre humain, c’est la situation existentielle dans laquelle se trouve actuellement plongée la personne singulière qu’il faut ici considérer. Cette considération, cependant, n’aurait pas trouvé sa place dans la littérature rabbinique du f siècle, si elle n’avait appartenu déjà à l’histoire du prophétisme. Dans cette histoire, comme l’a montré II. Cohen, Ezechiel se distingue par le fait qu’au i on traire des prophètes sociaux, qui donnent du péché une lecture politique et juridique ou le sort de l’individu se confond entièrement avec le destin collectif de l’État d’Israël, il découvre sa source dans l’individu lui-même . Cette individualisation du péché va de pair avec une conception nouvelle de l’acte par lequel celui- il entre dans le monde : le mal commence moins avec Adam violant l’interdit formel et vide par lequel le Créateur affirme son autorité souveraine, qu’avec Caïn meurtrier de son frère. Ainsi, à ce que l’idée d’une culpabilité originelle, prise à la lettre, pouvait avoir d’inintelligible, l’idée d’une culpabilité originaire, en retenant l’esprit du récit de création, oppose une interprétation compatible avec la raison et le sens commun.
Tout change donc selon que l’on déclame : « Dans la faute je fus enfanté, pécheur m’a mère m’a conçu » ou que l’on déplore : « Il n’en est pas un qui fasse le bien, non, pas un seul ». L’idée d’une faute héréditaire, sans doute, est contradictoire, mais celle d’une liberté innocente ne l’est pas moins, si l’on veut bien donner à « innocente » un sens relatif à la conduite individuelle. La liberté ne mérite son nom que parce qu’elle a le choix du bien ou du mal. La supposer innocente serait supposer ou qu’elle choisit toujours le bien ou qu’elle ignore le mal. Mais, dans le premier cas, elle ne serait pas une liberté humaine ; et, dans le second, elle ne serait pas du tout une liberté (l’innocence ne se distinguant plus alors de l’ingénuité ou de la stupidité et perdant du même coup sa valeur morale). Sans doute Kierkegaard remarque-t-il que « dans l’homme depuis Adam, tout individu i ou doit avoir un état d’innocence analogue à celui d’Adam », mais il veut seulement rejeter de cette manière une interprétation déterministe et naturaliste du mythe d’où « sortirait un individu n’en étant pas un et qui ne serait qu’un simple in-plaire de son espèce », « sans qu’on pût pourtant lui ôter le propre de l’individu : la culpabilité ». L’antériorité d’un tel état d’innocence n’est pas chronologique mais purement logique : elle permet seulement de se représenter le « saut » qu’implique la liberté de l’homme qui « plonge dans son propre possible » et qui, lorsqu’il se relève, « se voit coupable ». C’ est dans ce sens que l’on peut lire déjà, dans l’Apocalypse de Baruch: « Adam n’est pas responsable, si ce n’est pour lui seul. Et tous nous sommes pour nous-mêmes Adam ». Plus qu’une préhistoire mythique du genre humain, c’est la situation existentielle dans laquelle se trouve actuellement plongée la personne singulière qu’il faut ici considérer. Cette considération, cependant, n’aurait pas trouvé sa place dans la littérature rabbinique du f siècle, si elle n’avait appartenu déjà à l’histoire du prophétisme. Dans cette histoire, comme l’a montré II. Cohen, Ezechiel se distingue par le fait qu’au i on traire des prophètes sociaux, qui donnent du péché une lecture politique et juridique ou le sort de l’individu se confond entièrement avec le destin collectif de l’État d’Israël, il découvre sa source dans l’individu lui-même . Cette individualisation du péché va de pair avec une conception nouvelle de l’acte par lequel celui- il entre dans le monde : le mal commence moins avec Adam violant l’interdit formel et vide par lequel le Créateur affirme son autorité souveraine, qu’avec Caïn meurtrier de son frère. Ainsi, à ce que l’idée d’une culpabilité originelle, prise à la lettre, pouvait avoir d’inintelligible, l’idée d’une culpabilité originaire, en retenant l’esprit du récit de création, oppose une interprétation compatible avec la raison et le sens commun.
Mais ne perd-elle pas par là même la fonction que la théodicée assignait à la doctrine du péché ? Ne rend elle pas plus difficile encore, autrement dit, la réduction de la souffrance à la faute ? L’exemple crucial de la souffrance des enfants le montre : s’il est impossible de comprendre pourquoi un enfant doit souffrir pour une faute qu’un autre a commise, il est plus impossible encore de comprendre pourquoi un enfant doit souffrir pour une faute que personne n’a commise. On a le choix entre une interprétation littérale que mine la contradiction d’une faute héréditaire et une interprétation libérale que l’individualisation du péché rend incapable de fournir une raison de ce que l’on doit bien pourtant continuer d’appeler le malheur innocent.
On semble échapper à ce dilemme si l’on remarque, à la suite de saint Paul, que l’aveu du péché ne peut être séparé, dans l’ensemble du corpus biblique, de l’espoir du salut, et que l’« abondance » de l’un suscite la « surabondance » de l’autre. Pour Ezechiel, déjà, le péché n’est que la condition négative e qui ouvre à 1’individu l’accès à l’humanité et à son but : l’individu délivré du péché ; aussi celui ci doit- il être pour lui « une nouvelle lumière » et s’intégrer à une économie non de la dette mais de la rédemption. Selon cette interprétation prospective et non plus rétrospective du commencement, seule est pertinente la polarité du péché et de la rédemption — le premier n’étant alors pour ainsi dire que l’occasion de la manifestation de la seconde. Sa théorie du « corps spirituel » —c’est-à-dire du corps promis à la résurrection et distingué ainsi du « corps animal » qui est celui de l’homme dans son état premier — montre que cette polarité n’est pas entièrement étrangère à saint Augustin ; elle l’amène à dire que l’homme perdu par le péché puis sauvé par le don de Dieu ne sera plus, comme Adam, assujetti à la pesanteur et à la corruption de la vie terrestre, mais « vivifié par l’esprit » et revêtu ainsi du privilège de la seule immortalité véritable45. Si la souffrance et la mort sont le « salaire du péché », le péché seul, paradoxalement, donne accès à la béatitude et à la vie éternelle. Mais cette interprétation n’élimine pas la difficulté principale : pourquoi devrait-on, pour être sauvé, avoir été d’abord châtié ? et, si disproportion entre le péché de l’homme et la grâce de Dieu il y a, la même disproportion n’existe-t-elle pas d’abord entre le péché de l’homme et le châtiment de Dieu ?
Dans cette perspective, d’ailleurs, le péché ne s’oppose pas à la vertu mais à la foi. Il nous empêche de croire que l’on soit coupable devant Dieu comme on l’est devant les hommes. Dans la catégorie du « devant Dieu », bien des commentateurs n’ont pas vu par hasard, à la suite de Kierkegaard, la preuve de l’incommensurabilité de la notion religieuse de péché et de la notion éthique et juridique de faute. Pourquoi l’invention du péché aurait-elle était nécessaire, si l’homme avait été coupable devant Dieu comme il l’est devant les hommes ? On peut penser même, dans une perspective phénoménologique qu’il n’est pas encore temps de privilégier, que l’excès du péché sur la faute « répond » pour ainsi dire à l’excès d’une expérience qui trouve en lui son expression et qui n’est autre que la souffrance. Le texte de Genèse, sur le péché originel est aussi —et sans doute d’abord — un « discours de la souffrance » où la souffrance elle-même parle et cherche son sens. Mais, si la souffrance trouve en lui son expression, elle ne saurait trouver aussi en lui sa justification. Affirmer l’incommensurabilité du péché et de la faute, c’est formuler une nouvelle objection contre une théologie morale qui est précisément celle que met en œuvre la théodicée lorsqu’elle privilégie l’interprétation littérale des textes et tient la souffrance pour la punition d’une action coupable. Le discours sur le péché est aussi un discours sur la souffrance — mais sur une souffrance irréductible à la faute.
On pourrait, il est vrai, pour sauver la théodicée, renoncer à l’approfondissement philosophique et religieux de la notion de péché et lui préférer cette interprétation littérale. C’est cependant cette interprétation qui s’offre aux objections les plus graves.