Être de devoir-être : L'origine de la raison pratique
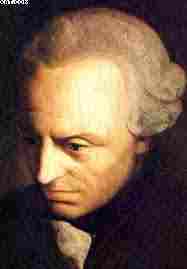 La thèse kantienne selon laquelle la raison, pure, est pratique, ne marque pas seulement les bornes de la raison théorique et de la raison instrumentale, elle met encore au jour un désir de justice étranger à toute volonté de savoir. Mais ce que Kant admet sur le plan politique : qu’il faut à l’individu « un maître qui brise sa volonté et qui le force à s’élever à une volonté universelle », on doit l’admettre alors sur le plan éthique. L’universel ne peut être référé en effet à la seule forme d’une « loi » dont nul ne sait comment elle pourrait, par elle-même, affecter notre personne, mais à tous ceux que leur commune capacité de souffrir rend susceptibles d’une telle affect ion et fait pour cela membres d’une même humanité. La souffrance, sans doute, suspend les rationalités instituées; elle révèle la « folie de la vie ». Mais cette folie même fait naître un intérêt pur pour la raison. Elle est la manière déraisonnable dont la raison vient au monde. La raison aurait-elle le pouvoir de produire en nous un sentiment moral c’est-à-dire, selon la définition qu’en donne Kant, un sentiment favorable à l’influence de la loi sur la volonté —, si nous n’étions ontologiquement prédisposés à éprouver un tel sentiment? Pourrait-elle imprimer sa forme à la sensibilité, si celle-ci n’avait réciproquement la forme de la raison? Relation immédiatement et problématiquement nouée entre la sensibilité et la Loi, entre la chair et l’idée, entre le fini et l’infini — telle est précisément la souffrance. En elle s’enracinent et s’articulent dès l’origine pathos et logos.
La thèse kantienne selon laquelle la raison, pure, est pratique, ne marque pas seulement les bornes de la raison théorique et de la raison instrumentale, elle met encore au jour un désir de justice étranger à toute volonté de savoir. Mais ce que Kant admet sur le plan politique : qu’il faut à l’individu « un maître qui brise sa volonté et qui le force à s’élever à une volonté universelle », on doit l’admettre alors sur le plan éthique. L’universel ne peut être référé en effet à la seule forme d’une « loi » dont nul ne sait comment elle pourrait, par elle-même, affecter notre personne, mais à tous ceux que leur commune capacité de souffrir rend susceptibles d’une telle affect ion et fait pour cela membres d’une même humanité. La souffrance, sans doute, suspend les rationalités instituées; elle révèle la « folie de la vie ». Mais cette folie même fait naître un intérêt pur pour la raison. Elle est la manière déraisonnable dont la raison vient au monde. La raison aurait-elle le pouvoir de produire en nous un sentiment moral c’est-à-dire, selon la définition qu’en donne Kant, un sentiment favorable à l’influence de la loi sur la volonté —, si nous n’étions ontologiquement prédisposés à éprouver un tel sentiment? Pourrait-elle imprimer sa forme à la sensibilité, si celle-ci n’avait réciproquement la forme de la raison? Relation immédiatement et problématiquement nouée entre la sensibilité et la Loi, entre la chair et l’idée, entre le fini et l’infini — telle est précisément la souffrance. En elle s’enracinent et s’articulent dès l’origine pathos et logos.
L’homme révolté, selon Camus, dit à la fois non à ce qui est et oui à ce qui doit être : au point aveugle où se ferme le monde et où s’abîment les significations, il réclame une nouvelle institution du sens, ( »est cette conjonction, dans sa personne, d’une négation et d’une affirmation, qui le distingue du nihiliste. Sa réaction prouve autant la victoire que la défaite de la volonté. Elle est précisément l’action d’une volonté qui ne consent pas à sa propre faiblesse. Cette volonté toutefois ne veut pas seulement vivre, bile ne se prend pas elle-même pour lin. bile n’est pas volonté de puissance. Les réserves d’affirmation qu’elle découvre en soi, outre qu’elle n’en dispose pas, convergent toutes vers un idéal qui n’est pas l’autre nom du néant mais l’aspiration, ancrée dans la vie elle-même, à une autre manière de vivre. L’expérience de l’injustifiable enveloppe ainsi une exigence de justification qui survit à l’échec de la spéculation et qui ne se distingue plus d’une exigence de régénération dont J. Nabert a montré qu’elle structurait originairement notre effort même pour être. L’incohérence et la cohérence s’y trouvent données d’un coup selon les modes opposés de l’indicatif et de l’impératif.
On pourrait déplorer, il est vrai, la forme au premier abord purement négative d’un tel impératif: dans la perspective ouverte par la souffrance, prescrire est d’abord proscrire; quelque chose doit être parce que quelque chose ne doit pas être. Mais ce devoir stresse passe, dans la souffrance, comme désir de l’Autre. La rigueur de l’impératif ne peut pas être détachée en elle de la ferveur d’une préférence dont nous ne sommes pas nous-mêmes l’objet. Encore une fois, l’héroïsme apparent de la formule kantienne du devoir — « tu dois donc tu peux — ne doit pas tromper. Il ne signifie nullement que l’homme puisse, par ses seules forces, ôter tout le mal qui est dans le monde! A la fois ironique et tragique’1, il exprime ensemble une exigence adressée au moi et une espérance dont le point d’ancrage se trouve ailleurs que dans celui-ci.