Doit-on se poser la question de savoir si les thèses philosophiques sont vraies ou fausses
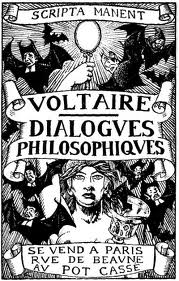
Platon affirme que ce qui est réel, ce sont des entités abstraites, les Formes, dont toutes les choses sensibles ne sont que des copies. Berkeley dit qu’il n’existe pas de choses matérielles, seulement des idées et des esprits qui les perçoivent. Kant prétend que nous ne pouvons pas connaître les choses elles-mêmes, seulement les phénomènes, les choses en tant qu’elles nous sont données dans une expérience. Est-ce vrai ou faux ?
Bien des professeurs de philosophie jugent naïf le fait de se poser cette question. La naïveté revient ici à appliquer aux philosophies du passé, et aux textes dans lesquels nous les trouvons, une catégorie inadéquate, celle de vérité (ou de fausseté). Mais pourquoi les énoncés philosophiques ne seraient-ils pas évaluables en termes de vérité et de fausseté ?
À cette question, certains répondent que les philosophes – du moins, les grands philosophes ayant écrits les grands textes – sont tellement au-dessus de nous, que nous devrions simplement nous mettre à leur école, sans nous demander s’ils disent vrai. L’attitude adéquate est celle de l’apprenti peintre, du moins dans la formation qui était autrefois celle des écoles des beaux-arts. Ils copiaient les tableaux des grands maîtres, s’imprégnant ainsi de la Peinture. Cela n’aurait que peu de sens que l’apprenti philosophe recopie les textes de grands philosophes, puisque le texte recopié n’est finalement pas une copie du texte, comme l’est un tableau, mais le texte lui-même. Le commentaire correspond cependant à l’activité de copie d’un tableau. On peut parler d’une attitude de «déférence textuelle» (Smith, 1991). Il ne s’agit pas d’un simple respect pour un travail intellectuel proposé à la réflexion critique de son lecteur. Car l’attitude consistant à s’efforcer de ne pas faire dire à l’auteur ce qu’il n’a pas dit suffit à cet égard largement. Elle n’implique pas de suspension aléthique, consistant à refuser de se demander si les affirmations sont vraies ou non. La déférence textuelle en revanche traite le texte de façon sacrée. Il devient parfois l’objet d’une forme de vénération.
Un commentaire ne vise généralement pas à déterminer si l’auteur a raison, mais à donner le moyen de comprendre un texte qui, sans cette glose, ne serait pas directement intelligible. Cela peut tenir à sa densité, sa difficulté ou à son obscurité, parfois aussi à son caractère ésotérique ou à son style. Par exemple, le style aphoristique encourage le commentaire; les fragments – mais il s’agit alors d’un accident dans l’histoire de la conservation d’un texte – l’encouragent également. Le commentateur suppose qu’un texte, en tant que tel, possède une importance intrinsèque. Dans l’Antiquité, les textes d’Homère ont fait l’objet de commentaires liés au rôle fondateur qu’ils ont joué dans la Grèce ancienne. Dans la tradition du commentaire biblique, cela tient à l’inspiration divine du texte. Si Dieu parle à travers le texte, chaque mot compte. Quand l’inspiration divine est mise en question, le commentaire historique prétend révéler les différentes sources du texte biblique, et comment son rôle fondateur a pu s’établir. De la même façon, le grand texte philosophique (Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel) fait l’objet d’un examen scrupuleux. L’auteur a une autorité : on doit le comprendre et l’interpréter, non pas le discuter et moins encore le mettre en question. Se demander si un philosophe a raison reviendrait à se placer dans une position de parité avec lui, alors qu’il est un maître. Cependant, le commentaire n’a pas toujours été ainsi conçu. Quand saint Thomas commente Aristote, il ne cherche pas seulement à comprendre, mais à savoir si c’est vrai. Dans cette attitude, le « risque » serait alors que le commentaire devienne le véhicule, pour le commentateur, de ses propres idées, ce qui est parfois reproché au commentaire d’Aristote par saint Thomas, et non un effort de compréhension du texte commenté. Surtout, c’est une attitude qu’il ne serait pas sage d’adopter dans l’enseignement de la philosophie, car le novice doit d’abord comprendre avant de critiquer.
Il n’est pourtant pas évident qu’on puisse comprendre ce que dit un texte de philosophie sans se poser la question de savoir si ce qu’il affirme est vrai ou non. On peut en effet supposer qu’un texte de philosophie contient des assertions. Or, quelqu’un qui écrit une assertion ou un ensemble d’assertions a pour finalité de dire quelque chose de vrai. Comprendre ce qu’il dit revient à lui attribuer cette intention de dire la vérité. Il ne paraît alors pas déraisonnable de penser qu’il est dans l’intention de l’auteur que nous reconnaissions la vérité de ce qu’il dit. Ce qui suppose d’examiner si ce qu’il dit est vrai. Bien sûr, il peut mentir, flatter, vouloir impressionner ou séduire, plutôt que de dire la vérité. Mais même dans ce cas, le texte se présente comme ayant pour finalité de dire la vérité. C’est l’interprétation que nous en faisons, en nous demandant si ce qui est dit est vrai ou non, qui nous permet de conclure que, finalement, le philosophe voulait moins faire une assertion que tromper, flatter, impressionner, séduire. Ou bien nous conclurons qu’il croyait faire une assertion, mais faisait autre chose. Par exemple, il exprimait les présupposés philosophiques d’une classe sociale ou d’un pouvoir. Autrement dit, la découverte du sens d’un texte philosophique semble difficilement pouvoir s’envisager sous une autre forme qu’une interrogation sur la valeur de vérité de ce qu’il affirme. Si l’on peut admettre qu’on puisse pratiquer la suspension aléthique (mettre entre parenthèses la question de la vérité) au sujet de textes littéraires, poétiques en particulier – et même si cela me semble aussi contestable – pourquoi devrait-on le faire, et le faire systématiquement, pour des textes philosophiques? La réponse à cette question peut consister à dire que les textes philosophiques sont écrits dans un langage hermétique. Ils requièrent un apprentissage lors duquel on pénètre leur sens. Mais la question revient: est-il possible de comprendre un texte philosophique sans se poser la question de savoir si ce qu’il dit est vrai ? Si la nécessité du commentaire des textes philosophiques tient à leur difficulté, en quoi cela implique-t-il la suspension aléthique ?
L’attitude de suspension aléthique a une fonction dans le cadre de l’apprentissage à l’intérieur d’une tradition, au sein de laquelle on accepte une autorité commune. Cela a pu, à travers les âges, être l’autorité de Pythagore, Platon, Aristote, saint Augustin, saint Thomas, Descartes, Spinoza, Hegel, Marx, Heidegger, Wittgenstein. Chacun de ces philosophes a fait l’objet exclusif d’une telle attitude déférente et le fait encore – sauf, me semble-t-il, Pythagore. Il est vrai que pour entrer dans une tradition de pensée, on doit y être formé. Les questions que l’on se pose sont alors celles de la bonne compréhension de cette tradition, pas celle de sa vérité. Cependant, la philosophie peut-elle se pratiquer correctement de cette façon, dans un cadre doctrinal fermé où les réponses sont données préalablement aux questions? Surtout, dans le cadre d’un enseignement de la philosophie qui ne serait pas celui d’une tradition particulière, quel sens cela aurait-il d’adopter cette attitude déférente à l’égard de tous les grands philosophes ? Inévitablement, on se heurte à une pluralité de thèses incompatibles. Elles se présentent toutes comme vraies. Comment l’apprenti philosophe pourrait-il de ne pas s’inquiéter de cette contradiction des doctrines ? Si un philosophe dit A et un autre non A, est-il encore possible de sous- entendre que cela n’a aucune importance de savoir si l’un des deux a tort ou raison ?
Il existe une réponse à cette question. C’est celle de Martial Gueroult dans sa Dianoématique, une œuvre impressionnante en deux livres. Le premier est une histoire de l’histoire de la philosophie ; le second livre est intitulé Philosophie et Histoire de la Philosophie (1979). Le titre général de «dianoématique», désigne, pour l’auteur, une discipline portant sur les conditions de possibilités des philosophies. Le livre II pose la question de savoir à quelle condition est possible la réalité objective des philosophies pourtant contradictoires. Premièrement, chaque système philosophique est une réalité irréductible. Deuxièmement, le réel est ce que dit être une philosophie. Pour Gueroult, Ce ne sont plus les différentes philosophies qui ont à justifier de leur réalité à l’égard du réel commun, mais c’est la réalité de ce réel commun qui, mise en question par les actes de la pensée philosophante, doit se trouver justifiée par elle et finalement posée par elle. (1979, p. 106)
Ce qui est vraiment réel est le système philosophique lui- même. Il engendre la réalité à laquelle nous serions, naïvement, tentés de croire qu’il correspond. Dès lors,
Les philosophies, cessant d’être des images [de la réalité], ne peuvent plus être dites vraies (puisqu’il n’y a plus correspondance avec un objet extérieur à elles) ; elles ne peuvent plus être dites que réelles. (1979, p. 107)
La vérité, identifiée à la correspondance, est remplacée par la systématicité, c’est-à-dire la cohérence interne. « Comme nous savons maintenant que le concept d’un tel modèle extérieur [à chaque système philosophique] est illusoire, il faut maintenant expliquer la source de cette illusion», dit Gueroult (1979, p. 165). Cela suppose d’adopter une thèse d’un idéalisme radical (hérité de Fichte). La réalité est produite par l’esprit, et elle ne lui est nullement extérieure.
Cependant, pour qui n’est pas tenté par cette forme radicale d’idéalisme, la conception dans laquelle ce qui fait la valeur d’une conception philosophique est qu’elle est, sinon vraie, du moins plausible, garde toute sa valeur. L’examen de cette plausibilité s’accompagne d’une interrogation sur la vérité ou la fausseté des affirmations qu’elle comprend. Ce qui peut paraître surprenant dans les travaux de maints historiens de la philosophie, surtout dans la seconde moitié du xxesiècle, est l’absence de toute considération pour cette simple question de savoir si ce que disent les auteurs qu’ils étudient est vrai ou faux. Se demander si Descartes, Kant ou Hegel ne se trompent pas est même pour eux une idée déplacée. L’histoire de la philosophie est alors devenue un ensemble de chefs-d’œuvre, intéressants par leur cohérence, leur caractère intellectuellement audacieux, subversif, attirant d’une façon ou d’une autre, mais sans que jamais on ne doive se poser la question de savoir si ce que disait tel ou tel philosophe est tenable. En ce sens, l’histoire de la philosophie pratiquée en France, semble avoir été sensible aux conceptions postmodernes qui récusent la notion de vérité (voir éclairage n° 8, « Qu’est-ce qu’être postmoderne ? »), et en a même été solidaire. Comme cette suspension aléthique en histoire de la philosophie se pratique couramment dans l’enseignement de la philosophie, particulièrement dans le cadre des concours qui recrutent les professeurs de philosophie, on peut se demander si ce postmodernisme n’a pas pénétré profondément la pratique de la philosophie en langue française.
Les philosophies du passé sont-elles des philosophies dépassées ?
Cela va-t-il de soi que l’enseignement de la philosophie ait à comprendre une part d’histoire de la philosophie? Après tout, les enseignements des mathématiques, de la physique ou de la biologie se font indépendamment de l’histoire de ces disciplines, indépendamment aussi de ce qu’on appelle l’histoire des idées (l’étude de la naissance, du développement et parfois de l’extinction des conceptions théoriques, dans différents domaines – philosophiques, scientifiques, culturels – et des relations que ces conceptions entretiennent avec l’histoire sociale et politique). Certains le regrettent car, pensent-ils, des difficultés de compréhension pourraient être levées par une approche historique des sciences «dures». Pour eux, les théories scientifiques sont mieux appréhendées en termes de leur découverte, des obstacles qu’il a fallu vaincre pour y parvenir, des autres conceptions qu’elles ont dû supplanter, et des modifications de concepts que le changement scientifique suppose. Par exemple, comprendre ce qui s’est joué avec Copernic, Kepler, Galilée, Newton, n’a rien de secondaire ou de superflu pour saisir ce qu’est la physique moderne.
Il reste qu’un physicien ne connaissant rien à l’histoire de sa discipline, cela n’étonne personne. En revanche, un philosophe ne connaissant rien à Platon, Aristote et Descartes, cela paraîtrait étrange, voire suspect. On demande aux élèves et aux étudiants en physique de comprendre et de connaître des théories physiques, de pouvoir les appliquer au besoin, mais pas de savoir d’où elles viennent. L’enseignement des sciences est anhistorique. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la philosophie ?
La relation particulière que la philosophie a avec son histoire tient au fait que les philosophes du passé ne sont pas des philosophes dépassés. Comparons encore, à cet égard, la physique et la philosophie. La connaissance des théories physiques des Médiévaux, ou celle des traités de physique d’Aristote, est historiquement intéressante. Elle permet vraisemblablement de mieux comprendre la spécificité de la physique moderne, tout comme la connaissance de cette dernière, c’est-à-dire des époques de Galilée et de Newton, permet d’apprécier les modifications postérieures de conceptions, voire de paradigmes. (Un paradigme – terme emprunté à Thomas Kuhn (1983) est un ensemble de théories scientifiques reposant sur un modèle cohérent et global. Selon certains historiens des sciences, les recherches scientifiques à une époque donnée se feraient à l’intérieur d’un paradigme, tout comme leur justification épistémologique.)
Cependant, on ne peut pas apprendre la physique en lisant Aristote ou des traités médiévaux. On apprend ce que certains Grecs ou certains Médiévaux croyaient correct, par exemple au sujet de la chute des corps ou de l’inertie. Nous savons maintenant que ce qu’ils croyaient était erroné. Cependant, nous pouvons aussi comprendre pourquoi et comment des êtres rationnels, voire supérieurement intelligents, comme Aristote ou Jean Buridan, se trompaient. Leurs erreurs n’étaient pas des absurdités; elles étaient liées à un ensemble de présupposés que nous avons abandonnés, et auxquels ils n’adhéraient pas toujours en connaissance de cause. Nous pouvons aussi penser que, dans l’avenir, notre science actuelle sera elle aussi sujette à caution. On fera à notre égard ce que nous faisons pour les Anciens, les Médiévaux ou les Classiques. Remarquons aussi que, même si la physique d’Aristote est obsolète, les concepts philosophiques auxquels elle recoure, ceux de causalité ou de hasard, sont détachables des affirmations sur les causes de la chute des corps, par exemple. Au sein d’une évolution des savoirs, permettant de préciser quels sont ceux qui n’ont plus cours, les thèses et les arguments philosophiques ne sont pas à ce point indexés à leur moment historique qu’on ne puisse les en extraire. À la différence des savoirs scientifiques, les thèses et les arguments philosophiques transcendent leur époque. À cet égard, nous trouvons notre bonheur aussi bien chez Platon, Aristote, Duns Scot, Descartes ou Kant, que dans le dernier article de Mind (l’une des grandes revues de philosophie en langue anglaise) ou de la Revue de Métaphysique et de Morale.
S’il est possible de séparer les thèses et les arguments philosophiques de leur époque d’apparition, alors les thèses philosophiques, les arguments, voire les concepts philosophiques, ne sont pas éliminables sur la seule base de l’ancienneté historique. On peut aussi remarquer qu’à un moment historique donné, il n’y a pas qu’une seule théorie philosophique, mais plusieurs, souvent incompatibles. Si plusieurs théories philosophiques contradictoires apparaissent dans la même situation historique, le principe de détermination historique ne permet plus de dire que leur appartenance à un passé révolu les rend caduques. Ou alors, il faudrait que des thèses incompatibles soient rejetées en fonction de leur ancienneté, et non du fait de leur contenu. (Comme on jette un yaourt dont la date de péremption est dépassée, même si, parfois, il reste mangeable, au moins un certain temps.)
Curieusement peut-être, en sortant les thèses philosophiques de l’histoire, l’importance de l’histoire de la philosophie pour le philosophe apparaît plus nettement. Elle lui importe parce qu’il ne s’agit pas de l’histoire de thèses obsolètes. Si ces thèses ne sont pas obsolètes, c’est qu’elles échappent à l’histoire. Cette conception cependant serait rejetée fermement par les philosophes pour lesquels l’histoire est en elle-même porteuse d’un sens. Toute prétention de détacher une production intellectuelle du processus historique serait condamnable, parce qu’elle en ignorerait le caractère déterminant. Un philosophe marxiste pense ainsi que cette prétention est l’une des formes prises par le conservatisme social lorsqu’il s’exprime sous une forme philosophique : il traite les thèses et les arguments philosophiques comme s’ils étaient indépendants du mouvement de l’histoire qui les engendre. Sous diverses formes, cette thèse marque la philosophie contemporaine. Elle caractérise une part importante de la philosophie continentale, comprise comme une herméneutique de l’époque. Elle a conduit beaucoup de philosophes à s’interroger gravement sur le moment où nous sommes. Ces derniers se donnent comme capables de saisir l’esprit du temps, qui échapperait généralement au commun des mortels. On peut cependant douter que les philosophes soient à cet égard mieux armés que les autres. Et à supposer même qu’il y ait un esprit du temps, quelle valeur explicative a-t-il au sujet de ce que nous sommes, faisons et pensons ?