La volonté faible : Raison et déraison du vice
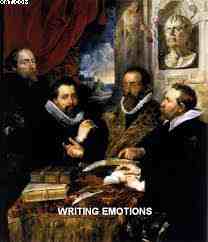 Non que cette conclusion soit nécessaire : c’est toute l’ambiguïté de la théorie du syllogisme pratique, qui compare nos conduites à des raisonnements ou, plus exactement, aux conclusions de raisonnements dont les prémisses resteraient implicites, que de le laisser croire. En dépit de l’analogie, que paraît impliquer cette théorie, entre la rationalité de la science et celle de l’action, le lien qui unit une conduite aux dispositions et aux propositions qui la fondent, n’est pas du même type que celui qui unit, dans la démonstration géométrique, un théorème aux axiomes, aux postulats et aux définitions dont il est déduit. Il n’est pas non plus assimilable au lien causal qui unit les événements qui se produisent dans la nature. Certes, pour expliquer nos actions, nous sommes souvent amenés à leur prêter, selon les cas, la forme d’une inférence ou d’une relation causale ; nous dirons par exemple que, « si l’on veut échapper à la prison, alors il faut obéir aux lois », ou que l’« on obéit aux lois parce que l’on ne veut pas aller en prison ». Mais, qu’on choisisse le langage des raisons ou celui des causes, il faudrait précisément distinguer ici entre Faction s’accomplissant et la reconstruction qu’en propose après-coup la réflexion. Celui qui, pratiquement, obéit aux lois et agit ainsi par crainte de la prison, se conforme à une nécessité morale et non à une nécessité logique ou à une détermination de type causal. La preuve en est qu’il peut aussi désobéir ou, s’il obéit, le faire pour de meilleurs motifs.
Non que cette conclusion soit nécessaire : c’est toute l’ambiguïté de la théorie du syllogisme pratique, qui compare nos conduites à des raisonnements ou, plus exactement, aux conclusions de raisonnements dont les prémisses resteraient implicites, que de le laisser croire. En dépit de l’analogie, que paraît impliquer cette théorie, entre la rationalité de la science et celle de l’action, le lien qui unit une conduite aux dispositions et aux propositions qui la fondent, n’est pas du même type que celui qui unit, dans la démonstration géométrique, un théorème aux axiomes, aux postulats et aux définitions dont il est déduit. Il n’est pas non plus assimilable au lien causal qui unit les événements qui se produisent dans la nature. Certes, pour expliquer nos actions, nous sommes souvent amenés à leur prêter, selon les cas, la forme d’une inférence ou d’une relation causale ; nous dirons par exemple que, « si l’on veut échapper à la prison, alors il faut obéir aux lois », ou que l’« on obéit aux lois parce que l’on ne veut pas aller en prison ». Mais, qu’on choisisse le langage des raisons ou celui des causes, il faudrait précisément distinguer ici entre Faction s’accomplissant et la reconstruction qu’en propose après-coup la réflexion. Celui qui, pratiquement, obéit aux lois et agit ainsi par crainte de la prison, se conforme à une nécessité morale et non à une nécessité logique ou à une détermination de type causal. La preuve en est qu’il peut aussi désobéir ou, s’il obéit, le faire pour de meilleurs motifs.
Quelle que soit la rationalité de nos conduites, elle échappe de plusieurs manières à ce qui est, sur le plan logique, le principe des principes : le principe de contradiction. La critique aristotélicienne de la « thèse socratique » signifie avant tout que l’action humaine, bien qu’elle n’aille jamais sans règle, ne se laisse cependant déduire d’aucune. Il dépend de nous à la fois d’admettre, dans nos raisonnements pratiques, telle et telle prémisse (ainsi, dans les exemples qui précèdent, que tout plaisir est un bien, ou que la prison est un mal), et d’agir ou de ne pas agir conformément à la conclusion qui suit logiquement de ces prémisses. Nous pouvons savoir que le tyran est le plus malheureux tics hommes et ne pas vouloir être malheureux et nous conduire néanmoins en tyran. Nous pouvons, de même, mentir à quelqu’un en sachant qu’il ne nous croira pas et alors même que nous voulons passer à ses yeux pour quelqu’un de sincère. Apparemment illogiques, ces conduites ne sont pas forcément déraisonnables. Elles n’autorisent en tout cas nullement à conclure au non-sens ou à la folie. En remarquant que le Diable n’agit pas moins systématiquement que Dieu , Scheler montre, réciproquement, qu’une conduite peut être à la fois logique et déraisonnable.
D’une certaine manière, il est vrai, l’extermination des juifs d’Europe est la conclusion d’un syllogisme dont les prémisses mobilisent, entre autres, les notions d’« espace vital » et de « supériorité de la race aryenne ». Mais le mal n’est pas tant, alors, de « se laisser prendre a quelque postulat vulgaire et pré critique », que d’« échanger la liberté inhérente a la faculté humaine de penser [et d’agir | pour la camisole de la logique ». En procédant à cet échange, l’homme n’accomplit donc pas une action déterminée : il renonce à exister lui-même comme être agissant. La perversion de sa conduite ne consiste pas dans la soumission délibérée de sa volonté à une passion qui en deviendrait la règle : elle est plus radicalement la perversion des structures mêmes de l’agir et du pâtir. Quand l’une met en enivre des règles essentiellement différentes de celles qui gouvernent nos déductions logiques, l’autre réduit d’une certaine manière les premières aux secondes. De l’une à l’autre, il y a, on le verra, la distance qui sépare l’intempérance d’une forme de méchanceté qui est infiniment plus éloignée d’elle, qu ‘elle ne peut l’être elle-même de ta sagesse.
Il v a en effet une ressemblance entre l’intempérant et le sage : l’un et l’autre désirent, l’un et l’autre raisonnent, l’un et l’autre délibèrent, l’un et l’autre enfin calculent les moyens de réaliser les buts qu’ils se proposent et agissent en accord avec eux-mêmes. l’acrasia, encore une fois, ne doit pas être définie —comme pourraient l’être, en deux sens différents, l’impétuosité ou la débauche— par la passion et par l’absence de règle, mais par le choix d’une règle opposée à la droite règle. C’est une manière rationnelle de se montrer déraisonnable. On l’a vu : si la première découverte d’Aristote dans les textes qui traitent de l’acrasia est celle de la volonté libre, sa seconde découverte est celle de la différence qu’il y a entre l’intelligence théorique et une intelligence pratique dont témoigne précisément cette parenté formelle du vice et de la vertu. Ces découvertes permettent-elles d’opposer sans équivoque sa doctrine à celle qu’il attribue à Socrate et à Platon ? Il est d’autant moins facile de le dire qu’après avoir entrepris de réfuter celle-ci, Aristote paraît finalement la faire sienne.syllogisme pratique