Rien de nouveau sous le soleil ? Vs l'histoire de la philosophie comme grand récit
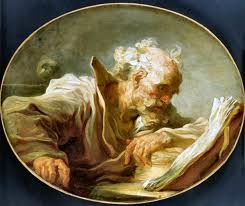 Cependant, dans les faits, la reconstruction historique en histoire de la philosophie s’avère souvent solidaire de la conception, celle de l’identité de la philosophie et de son histoire, et non de la thèse (l’indépendance). Il suffit de raisonner ainsi pour en arriver depuis le genre à la thèse . Quand on examine sérieusement et attentivement les grands textes de l’histoire de la philosophie, on s’aperçoit que tous les problèmes philosophiques d’aujourd’hui ont déjà été examinés par les philosophes du passé, ou presque. Des solutions ont été proposées au cours de l’histoire. Aucune ne s’est imposée. Le sens des concepts philosophiques fondamentaux a été modifié, bouleversé, réinterprété, revivifié. La philosophie d’aujourd’hui ne fait cependant rien d’autre que de reprendre ce qui est déjà apparu à différentes phases de l’histoire de la philosophie, sous d’autres formes. Voici ce qui peut alors arriver. Vous exposez (avec un certain enthousiasme) les thèses d’un philosophe contemporain. L’historien de la philosophie vous regarde, dépité ou légèrement condescendant, et dit: « Oui, mais cela se trouve déjà chez… ». L’idée est que toute thèse philosophique ne peut guère s’énoncer que dans les termes de l’histoire de la philosophie et doit être étudiée selon ses méthodes. Les thèses contemporaines ne le sont en fait jamais. Ce serait d’une grande naïveté historique de croire qu’il y a, en philosophie, quelque chose de nouveau sous le soleil.
Cependant, dans les faits, la reconstruction historique en histoire de la philosophie s’avère souvent solidaire de la conception, celle de l’identité de la philosophie et de son histoire, et non de la thèse (l’indépendance). Il suffit de raisonner ainsi pour en arriver depuis le genre à la thèse . Quand on examine sérieusement et attentivement les grands textes de l’histoire de la philosophie, on s’aperçoit que tous les problèmes philosophiques d’aujourd’hui ont déjà été examinés par les philosophes du passé, ou presque. Des solutions ont été proposées au cours de l’histoire. Aucune ne s’est imposée. Le sens des concepts philosophiques fondamentaux a été modifié, bouleversé, réinterprété, revivifié. La philosophie d’aujourd’hui ne fait cependant rien d’autre que de reprendre ce qui est déjà apparu à différentes phases de l’histoire de la philosophie, sous d’autres formes. Voici ce qui peut alors arriver. Vous exposez (avec un certain enthousiasme) les thèses d’un philosophe contemporain. L’historien de la philosophie vous regarde, dépité ou légèrement condescendant, et dit: « Oui, mais cela se trouve déjà chez… ». L’idée est que toute thèse philosophique ne peut guère s’énoncer que dans les termes de l’histoire de la philosophie et doit être étudiée selon ses méthodes. Les thèses contemporaines ne le sont en fait jamais. Ce serait d’une grande naïveté historique de croire qu’il y a, en philosophie, quelque chose de nouveau sous le soleil.
Souvent, cette attitude est aussi solidaire d’une forme de relativisme. Dans l’histoire de la philosophie, ne trouve-t-on pas finalement toutes les thèses, reprises sous forme de transformation et de dérive sémantique (de la signification des termes) ? Dès lors, la prétention à philosopher, afin de parvenir à une meilleure solution au sujet d’un problème philosophique supposé invariant, est naïve. La philosophie est l’histoire de la philosophie. Les objets véritables du philosophe ne sont pas des thèses qu’il examinerait en évaluant les arguments qui les soutiennent, ce sont des textes. Les philosophes du passé, même s’ils prétendaient, comme les philosophes d’aujourd’hui, formuler des thèses et les justifier, lisaient en réalité les textes de leurs prédécesseurs, les reformulant, les déformant, les réinterprétant. Nous ne sommes évidemment plus très loin alors de l’idée selon laquelle la philosophie est finie, qu’il ne reste plus guère qu’à examiner ce qu’elle fut, les textes qu’elle nous a légués, comme l’écume sur la plage quand la mer se retire. Cette attitude n’est pas marginale en France, aujourd’hui, dans l’enseignement de la philosophie. Elle enlève tout sens à l’idée d’une philosophie contemporaine, indépendante de l’histoire de la philosophie, laquelle prend dès lors toute la place et s’identifie à la philosophie. Enseigner la philosophie et faire de la philosophie – car c’est un tout -, cela revient à se plonger dans les textes de « grands auteurs », pour parvenir à en pénétrer la signification, ce qui suppose de les replacer dans un corpus externe de textes afin de repérer des dérivations historiques (archéologie philosophique) ou de saisir leur place dans une œuvre philosophique (méthode structurale).
C’est une attitude tout à fait différente, et presque inverse, qu’adoptent ceux qui font de l’histoire de la philosophie un grand récit, le genre (III). Pour eux, l’histoire de la philosophie est comme un scénario dans lequel on va de péripétie en péripétie, chacune étant inédite. Puisqu’il affirme finalement que nous ne pouvons comprendre la philosophie contemporaine qu’à l’intérieur d’un récit historique, au terme duquel nous nous trouverions, le genre (III) n’est pas compatible avec la thèse (1) (l’indépendance). Il s’ajuste en revanche bien avec la thèse (3) (la dépendance). La compréhension de la philosophie contemporaine revient à saisir le sens général de l’histoire de la philosophie, jusqu’à sa phase ultime. C’est aussi une façon d’envisager la thèse (4) (l’identité). La philosophie et l’histoire de la philosophie ne font qu’un si la philosophie consiste toujours à se situer à son terme historique. Elle ne consiste pas en thèses et arguments, mais en un récit sur les thèses et les arguments que des philosophes ont pu proposer. Les philosophes du passé, parce qu’ils étaient pris dans le développement historique, n’étaient pas dans la meilleure position pour se comprendre eux-mêmes. C’est à cet égard l’inverse de ce que dit l’historien de la reconstruction historique, qui cherche à comprendre les philosophes comme ils se sont eux-mêmes compris, et prétend pouvoir y parvenir. En revanche, la thèse (2), celle d’une simple corrélation, ne semble pas possible dans le genre (III).
Vidéo : Rien de nouveau sous le soleil ? Vs l’histoire de la philosophie comme grand récit
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Rien de nouveau sous le soleil ? Vs l’histoire de la philosophie comme grand récit
https://www.youtube.com/embed/tqbbjnDRKz4