Candide voltaire
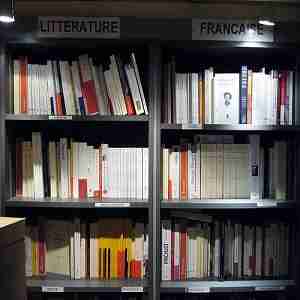
Candide, ou l’optimisme est un conte philosophique de Voltaire paru à Genève en Janvier 1759. Il a été réimprimé vingt fois la vie de l’auteur (plus de cinquante aujourd’hui), ce qui en fait l’un des français les plus réussies littéraire.
Candide est le titre complet de Candide ou l’optimisme, traduit par l’Ralph dits docteur, qui, en fait, est le Voltaire pseudonyme. Ce travail, ironiquement les premières lignes, ne laisse aucun doute sur l’origine de l’auteur, qui ne pouvait être le parti des philosophes: «Les anciens domestiques soupçonne que [Candide] était le fils de la sœur de M. le baron et une bonne et honnête gentilhomme du voisinage, que cette dame ne se marierait jamais, car il pourrait s’avérer que 71 districts, et le reste de son arbre généalogique avait été perdu par les ravages du temps. ‘
On peut voir immédiatement, à la fin du premier alinéa de l’oeuvre, le sarcasme moqueur le conservatisme social de la noblesse arrogante, certainement comme Molière il ya un siècle a été pratiquée au détriment de la petite aristocratie provinciale, mais aussi annonçant le Beaumarchais Figaro: «Si le ciel avait voulu, je serais le fils d’un prince.’.Candide est une histoire de la formation, l’histoire d’un voyage qui va transformer son héros éponyme comme un philosophe, un nouveau type de Télémaque.
L’onomastique, en interprétant les textes de Voltaire, est souvent fructueuse. Le mot «candide» vient du latin candidus qui signifie blanc. Le choix d’un tel nom l’indique l’innocence du héros ou de sa naïveté. L’ardoise vierge sur laquelle la marque en apparence, il a surpris de constater que tout au long de ses tribulations, comme en apparence enfantin Socrate dans les dialogues platoniciens, personnifiant et, selon l’étymologie du mot, l’ironie – εἰρωνεία (eironeia) – ignorance feinte.
Résumé
Candide est un jeune garçon vivant dans le château du baron de Thunder-ten-tronckh. Son maître, Pangloss un philosophe qui enseigne la «métaphysique-théologo-cosmologie nigologie» et professe, comme Leibniz, que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Mais Candide est expulsé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d’une «leçon de physique expérimentale’ entreprise avec Cunégonde, la fille du baron. Candide découvre le monde de déceptions et passe dans des déceptions.
Enrôlés dans les troupes bulgares, il a assisté au massacre de la guerre.Il s’est enfui, a été recueilli par Jacques l’anabaptiste. Il trouve Pangloss réduit à un vieil homme, souffrant de la variole dont il a appris le décès de Cunégonde, violées par des soldats bulgares. Ils sont montés avec Jacques à Lisbonne. Après un orage qui a noyé Jacques, ils arrivent à Lisbonne, le jour du tremblement de terre et sont victimes d’un feu de joie dans lequel Pangloss est pendu. Candide retrouva Cunégonde, la maîtresse d’un grand inquisiteur et d’un riche Juif de Don Issachar.They sont encouragés à tuer les deux hommes se sont enfuis avec Cunégonde et la vieille servante à Cadix en Espagne.
Il s’embarque avec son valet Cacambo, Cunégonde et la vieille servante pour le Paraguay. Forcé de quitter Cunégonde à Buenos Aires, il s’enfuit avec Cacambo Paraguay. Ils constatent que le frère de Cunégonde poignarde Candide d’une épée, d’évasion, d’éviter peu susceptibles d’être mangés par les oreillons sauvages et découvrir le pays d’Eldorado. Ils sont heureux avec mais je préfère laisser toutes leurs richesses à trouver Cunégonde.
Envoi acheter Cacambo Cunégonde, Candide est volé par un commerçant et un juge, a rencontré Martin, dégoûté de la vie et a rejoint l’Europe avec lui.Ils passent par Paris, où il mourut le manque Candide de soins en médecine, est volé par un abbé et échappe de justesse la prison, puis rejoindre à Venise où ils cherchent en vain Cacambo et Cunégonde. Ils y rencontrent Paquette, la servante du baron de Thunder-ter-tronckh, son amant et la giroflée moine de découvrir une riche sont désillusionnés et la connaissance des six rois détrônés.
Ils ont ensuite passer à Constantinople offrir Cunégonde, deviennent laids esclave du roi et de racheter ceux qui sont tombés Ragotski valet Cacambo. La galère, parmi les condamnés, ils trouvent Pangloss, qui ont échappé à la potence, et le frère de Cunégonde, qui se sont échappés de l’épée, qui fournit contre Candide rançon. A Constantinople, il a acheté Cunégonde laide et acariâtre, la femme contre l’avis de son frère, il est contraint de chasser, de s’installer dans une ferme, est volé par les marchands, recueille et Paquette Giroflée et finalement cultiver son jardin sans se soucier du monde.
‘Pangloss disait quelquefois à Candide:«Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles;car, après tout, si vous n’aviez pas été entraîné par un beau château avec grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’avez pas l’Amérique a couru à pied, si vous n’avez pas donné une bonne épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne seriez pas manger ici et confits pistache cédrat .- C’est bien dit, répondit Candide, mais il nous faut cultiver notre jardin». ‘
Résumé
Candide est un jeune garçon vivant dans le château du baron de Thunder-ten-tronckh. Son maître, Pangloss un philosophe qui enseigne la «métaphysique-théologo-cosmologie nigologie» et professe, comme Leibniz, que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Mais Candide est expulsé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d’une «leçon de physique expérimentale’ entreprise avec Cunégonde, la fille du baron. Candide découvre le monde de déceptions et passe dans des déceptions.
Enrôlés dans les troupes bulgares, il a assisté au massacre de la guerre. Il s’est enfui, a été recueilli par Jacques l’anabaptiste. Il trouve Pangloss réduit à un vieil homme, souffrant de la variole dont il a appris le décès de Cunégonde, violées par des soldats bulgares. Ils sont montés avec Jacques à Lisbonne.Après un orage qui a noyé Jacques, ils arrivent à Lisbonne, le jour du tremblement de terre et sont victimes d’un feu de joie dans lequel Pangloss est pendu. Candide retrouva Cunégonde, la maîtresse d’un grand inquisiteur et d’un riche Juif Don Issachar. Ils sont encouragés à tuer les deux hommes se sont enfuis avec Cunégonde et la vieille servante à Cadix en Espagne.
Il s’embarque avec son valet Cacambo, Cunégonde et la vieille servante pour le Paraguay. Forcé de quitter Cunégonde à Buenos Aires, il s’enfuit avec Cacambo Paraguay. Ils constatent que le frère de Cunégonde poignarde Candide d’une épée, d’évasion, d’éviter peu susceptibles d’être mangés par les oreillons sauvages et découvrir le pays d’Eldorado. Ils sont heureux avec mais je préfère laisser toutes leurs richesses à trouver Cunégonde.
Envoi acheter Cacambo Cunégonde, Candide est volé par un commerçant et un juge, a rencontré Martin, dégoûté de la vie et a rejoint l’Europe avec lui. Ils passent par Paris, où il mourut le manque Candide de soins en médecine, est volé par un abbé et échappe de justesse la prison, puis rejoindre Venise, où ils cherchent en vain Cacambo et Cunégonde. Ils y rencontrent Paquette, la servante du baron de Thunder-ter-tronckh, son amant et la giroflée moine, de découvrir un riche sont désillusionnés et la connaissance de six rois détrônés.
Ils ont ensuite passer à Constantinople offrir Cunégonde, deviennent laids esclave du roi et de racheter ceux qui sont tombés Ragotski valet Cacambo. La galère, parmi les condamnés, ils trouvent Pangloss, qui ont échappé à la potence, et le frère de Cunégonde,
qui se sont échappés de l’épée, comme Candide offre contre ransom.At Constantinople, il a acheté Cunégonde laide et acariâtre, la femme contre l’avis de son frère, il est contraint de chasser, de s’installer dans une ferme, est volé par les marchands, recueille et Paquette Giroflée et finalement cultiver son jardin sans se soucier du monde.
‘Pangloss disait quelquefois à Candide:«Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car après tout, si vous n’aviez pas été entraîné par un beau château avec grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde Si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’avez pas exécuté l’Amérique à pied, si vous n’avez pas donné une bonne épée au baron, si vous n’aviez pas perdu vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangez pas ici pour cédrat confit et pistaches .- Ce C’est bien dit, répondit Candide, mais il nous faut cultiver notre jardin». ‘
Contexte politique
Lorsqu’il est libéré, Voltaire a vécu dans la propriété des Délices à Genève, véritable «palais d’un philosophe avec les jardins d’Epicure». Deux événements récents ont choqué: le tremblement de terre de Lisbonne du 1er Novembre 1755 et le début de la guerre de Sept Ans (1756) qui a inspiré cette réflexion: «Presque toute l’histoire est une série d’atrocités inutiles» (Essai sur l’histoire générale, 1756 ).
Ayant envoyé son Poème sur le désastre de Lisbonne, Jean-Jacques Rousseau, ce dernier a répondu par une lettre dans laquelle il cherche à justifier la providence divine, que Voltaire doute fortement après ces événements. Il affirme, dans le neuvième livre de ses Confessions, le roman philosophique Candide est la réponse à cette lettre, la réponse de Voltaire l’avait promis, alors l’ajournement.
L’année précédant la publication de cet ouvrage, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Voltaire assisté, a un revers par le retrait du privilège royal et condamné par le Parlement de Paris. Voltaire aurait trouvé, avec Candide, un moyen de continuer à véhiculer les idées du siècle des Lumières. Afin d’atteindre amplement, étant donné le succès de ce livre, au lieu de recevoir uniquement élite fortunée et cultivée comme l’Encyclopédie, a touché presque tous les lettrés.
Depuis sa retraite en Suisse, parcourt le monde dans l’imagination de Voltaire. Progressivement, il tire quelques lignes dans un espace symbolique: Berlin et l’Allemagne dans le Pérou du Nord-Ouest, du Sud de Venise, Constantinople à l’Est. Ce sera les principaux sites du conte, les principales étapes du voyage de Candide. Il reste à les connecter. Allemagne, par exemple, évoque la Turquie par le même despotisme politique et entretient des liens avec l’Amérique du Sud par le jésuite allemand qui font la guerre dans les grandes étapes Paraguay.The désormais fixé, les personnages peuvent prendre la route. Est bien sûr de créer Candide …
Certains critiques ont vu ce personnage dans la réalisation de la naïveté de l’auteur lui-même. Baron, nom imprononçable, épris de sa noble naissance, qui va exclure Candide ‘Jardin d’Eden» symbolise la noblesse allemande, tandis que le «roi des Bulgares’ serait Frédéric II qui, en Novembre 1757, a couvert la gloire de la victoire de Rossbach. Voltaire, qui croyait à la défaite de son ancien patron, prend alors conscience de sa naïveté. Le conte serait une revanche de l’humiliation infligée par Frédéric II, après la querelle qui a bouleversé le philosophe avec le roi de Prusse en 1753.Traiter Frédéric II de «roi des Bulgares» est une manière indirecte de rappeler son orientation sexuelle, le terme «bougre» (lui-même dérivé de «bulgare») signifiant «homosexuel» dans le XVIIIe century.Here un extrait d’une lettre de Voltaire à Madame Denis, où le philosophe a été invité à Berlin, même s’il croyait en la possibilité d’un despotisme éclairé fait, exprime déjà sa méfiance du pouvoir royal:
«Je vais faire de mon éducation, un petit dictionnaire à l’usage des rois. Mon cher ami, vous êtes pour moi signifie bien plus que indifférent. Je vais vous faire dire par plaisir, je souffre comme j’ai besoin de toi. Souper avec moi ce soir je veux dire se moquer de vous ce soir. Le dictionnaire peut être long, c’est un article mis dans l’Encyclopédie».
– Voltaire, Berlin, 18 Décembre, 1752
La mise en scène des ordres religieux dans Candide est commun. Cela est dû au fait que Voltaire a été éduqué par les jésuites, à qui il a développé à la fois la gratitude et le ressentiment. Ainsi nous trouvons des épisodes tels que celui dans lequel frère du héros perce Cunégonde, est devenu un jésuite.
Référence
Dans son récit, les allusions place Voltaire de nombreux événements en cours à Paris.Par exemple, la suivante est une référence précise à des discussions à l’Académie des sciences:
‘
